par Daniel J. Berger | Avr 30, 2019
Un auteur (romancier) parle d’un auteur (vigneron). Nous avons choisi de revenir sur le livre de Sébastien Lapaque « Chez Marcel Lapierre » paru en 2004. Tous simplement parce qu’il trace une des voies du commentaire littéraire sur le vin comme ce blog l’ambitionne.
« Après tout, qu’est-ce que la littérature ? Elle tient tout entière dans ces deux phrases magnétiques [de la lettre de Madame de Sévigné « Ma chère bonne… »]
Madame de La Fayette remonte toujours le Rhône tout doucement. Et moi, ma fille, je vous aime avec la même inclination que ce fleuve va de Lyon dans la mer : cela est un peu poétique, mais cela est vrai.
comme elle tient tout entière dans les fulgurances de Vie de Rancé, un livre que je relis tous les ans au mois de juillet mais que j’ai relu en février cette année, je l’avais encore avec moi début mars, j’en ai récité des passages en mangeant des huîtres sauvages de Cancale arrosées de muscadet Amphibolite nature de Jo Landron. »
Tiens, tiens ! Qui écrit donc avec ce ton lyrique et raffiné qu’on a un peu oublié, qui rappelle celui des écrivains de la génération des Roger Nimier, Antoine Blondin, Michel Déon, Jacques Laurent, Félicien Marceau — les Hussards –, que les manuels de français de l’Education Nationale s’obstinent à ignorer, et auxquels on ajoutera leur aîné Jacques Perret, en remontant jusqu’à Marcel Aymé ?
 C’est Sébastien Lapaque (ci-contre). Romancier, essayiste et pamphlétaire, latiniste, journaliste au Figaro Magazine, au Monde Diplomatique, au Point, pigiste un peu partout, « talentueux écrivain de droite qui dit merde à la droite » selon l’Obs, il nous a confectionné un petit article savoureux — forcément savoureux venant de lui qui a pour ami le cuisinier béarnais Yves Camdeborde (1) –, dans La Revue des Deux Mondes de mai 2019 (pp. 100- 106) : une visite des préfaciers du Livre de Poche des débuts.
C’est Sébastien Lapaque (ci-contre). Romancier, essayiste et pamphlétaire, latiniste, journaliste au Figaro Magazine, au Monde Diplomatique, au Point, pigiste un peu partout, « talentueux écrivain de droite qui dit merde à la droite » selon l’Obs, il nous a confectionné un petit article savoureux — forcément savoureux venant de lui qui a pour ami le cuisinier béarnais Yves Camdeborde (1) –, dans La Revue des Deux Mondes de mai 2019 (pp. 100- 106) : une visite des préfaciers du Livre de Poche des débuts.
Roger Nimier éclairait alors Guy Schoeller, directeur de la collection et mentor de Françoise Sagan, sur le choix d’auteurs dont certains encore au purgatoire dix ans après l’Occupation comme Marcel Jouhandeau pour la Vie des douze Césars de Suétone ou Jacques Chardonne pour La Sonate à Kreutzer de Tolstoï. Et introduisait les jeunes Hussards justement, encore peu connus et souvent dans le besoin (de piges) — Antoine Blondin pour les Contes du Far West de O’Henry et le Cousin Pons, Félicien Marceau pour Madame Bovary et César Birotteau, Michel Déon pour Illusions perdues, Nimier lui-même pour Le Rouge et le Noir. Et puis Jacques Perret pour un volume réunissant de petits chefs d’œuvre de Balzac, L’illustre Gaudissart, Z. Marcas, Les Comédiens sans le savoir, Gaudissart II et Melmoth réconcilié. Et aussi Pierre Boutang pour Les Possédés.
Même s’il les possède dans une autre édition, Sébastien Lapaque aime fouiner chez les bouquinistes et acheter, pour le prix d’un café, ces Livre de Poche à couverture un peu salie et papier bon marché, pour leurs préfaces publiées dans les années 1953-68 : Maximes et Pensées de Chamfort préfacées par Camus, Bouvard et Pécuchet par Queneau, Les Fleurs du mal par Sartre, les Mémoires du Cardinal de Retz par Morand, qui présentait aussi Adelaïde (Gobineau), Les Dames galantes (Brantôme), Le Vicomte de Bragelone (Dumas), ou Une Vieille maîtresse (Barbey d’Aurevilly), par exemple.
Comme celle de Julien Gracq en 1964 pour les Mémoires d’Outre Tombe, sous le titre Le grand paon, déjà publiée dans Préférences chez José Corti (1961), ces textes souvent se suffisent à eux-mêmes tout en donnant envie de lire et relire le texte qu’ils préfacent. Ils mériteraient une édition commune, sans doute impossible en raison des droits. (1)
Pourquoi parler de lui dans mtonvin.net ?
 Parce qu’évidemment, il connaît le vin et qu’il a écrit un Chez Marcel Lapierre — vigneron pionnier du bio à Villié-Morgon que tout le monde respectait avant sa mort en 2010 et ne cesse de vénérer depuis. Ce petit livre paru en 2004 campe bien l’ambition de notre blog : goût, connaissance et culture du vin, placé sous le signe de la littérature et de la poésie, soignant la langue et le phrasé du récit, avec curiosité, sincérité des dégustations, bienveillance et fidélité envers les vigneronnes et vignerons.
Parce qu’évidemment, il connaît le vin et qu’il a écrit un Chez Marcel Lapierre — vigneron pionnier du bio à Villié-Morgon que tout le monde respectait avant sa mort en 2010 et ne cesse de vénérer depuis. Ce petit livre paru en 2004 campe bien l’ambition de notre blog : goût, connaissance et culture du vin, placé sous le signe de la littérature et de la poésie, soignant la langue et le phrasé du récit, avec curiosité, sincérité des dégustations, bienveillance et fidélité envers les vigneronnes et vignerons.
En mars 2011, j’en avais lu la première édition (ci-contre, publiée dans la collection Ecrivins chez Stock), sur la plage du Tembo House de Zanzibar, tout près du débarcadère des ferries ensablés, destination rêvée (le nom du lieu, comme Valparaiso) mais qui n’a pas développé en moi d’effet nostalgique marquant. Nulle coquetterie sur l’endroit, mon épouse et moi étions en voyage de noces, l’un des nombreux après le premier, qui n’a jamais eu lieu. (2)
Sans doute sous le coup du désastre de Fukushima 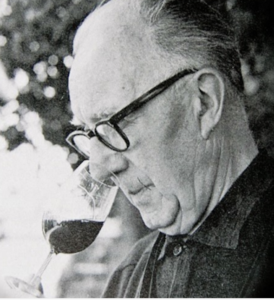 qui se propageait en direct sur les écrans de télévision de l’hôtel, j’étais passé à côté de ce petit chef d’œuvre de précision historique et d’amour fou, qu’un simple survol ne peut satisfaire. Sébastien Lapaque nous parle notamment de Jules Chauvet (à droite), qu’il qualifie de « Bouche d’or » (déguster et dire le vrai), négociant-éleveur en Beaujolais, chercheur et pédagogue, mort en 1989 à 82 ans. Cet homme d’hier et d’après-demain a le premier réénoncé les règles de la viticulture bio bien avant qu’on la nomme ainsi, en professant de « libérer les vins des levures exogènes, de la chaptalisation, de la filtration, de l’acide tartrique et surtout de ce maudit anhydride sulfureux qui fait tant de mal. » Si Lapaque en parle longuement c’est qu’il a beaucoup influencé Marcel Lapierre, parmi tant d’autres.
qui se propageait en direct sur les écrans de télévision de l’hôtel, j’étais passé à côté de ce petit chef d’œuvre de précision historique et d’amour fou, qu’un simple survol ne peut satisfaire. Sébastien Lapaque nous parle notamment de Jules Chauvet (à droite), qu’il qualifie de « Bouche d’or » (déguster et dire le vrai), négociant-éleveur en Beaujolais, chercheur et pédagogue, mort en 1989 à 82 ans. Cet homme d’hier et d’après-demain a le premier réénoncé les règles de la viticulture bio bien avant qu’on la nomme ainsi, en professant de « libérer les vins des levures exogènes, de la chaptalisation, de la filtration, de l’acide tartrique et surtout de ce maudit anhydride sulfureux qui fait tant de mal. » Si Lapaque en parle longuement c’est qu’il a beaucoup influencé Marcel Lapierre, parmi tant d’autres.
Il nous parle aussi de Pline l’Ancien (3) pour sa lucidité sur le maquillage des vins au 1er siècle, déjà, et sur le sens lucratif des propriétaires de vignobles, déjà. De Karl Marx, en se gardant de jouer au jeune-hussard-droite-alcoolisée, qui, lui aussi, dénonçait la viticulture capitaliste exploitant non seulement le travailleur appauvri mais aussi le sol appauvri, en ruinant ses ressources de fertilité. Et de Hegel et de Guy Debord.
Par son amour et son respect du vin qu’il aime (4), qui le poussent à approfondir sa connaissance concrète de la conception traditionnelle du vin année après année, du travail de la vigne et de la récolte, de la vinification et de l’élevage, et à l’écrire avec simplicité, dévouement à la cause du bon, et considération de et pour l’humain, Sébastien Lapaque montre le chemin à l’écrivin.
Dans Chez Marcel Lapierre, on lira son récit de l’aventure finalement pitoyable du beaujolais nouveau entre 1956 (15 000 hectolitres produits) et 1990 (600 000). En 2003, 500 viticulteurs avaient disparu, ce qui rend « plus héroïques et plus sympathiques les efforts de ceux [restants ou nouveaux] qui luttent pour redonner au beaujolais une part de sa sincérité native, » les onze crus, autant que le primeur « messager avant-coureur, […] vif, lampant, agile, friand, vin de soif et d’amitié qui donne envie de se retrouver autour d’un tonneau chargé de verres et de victuailles, et de se raconter des histoires. »
 Marcel Lapierre né en 1950 (ci-contre), avant même de rencontrer « le Socrate du Beaujolais » Jules Chauvet, « se faisait une certaine idée du vin, » s’employant à « rentrer en cave un gamay noir à jus blanc, riche de ses seules levures indigènes. »
Marcel Lapierre né en 1950 (ci-contre), avant même de rencontrer « le Socrate du Beaujolais » Jules Chauvet, « se faisait une certaine idée du vin, » s’employant à « rentrer en cave un gamay noir à jus blanc, riche de ses seules levures indigènes. »
Au fil des années il abandonne un à un les produits phyto- sanitaires, pesticides, herbicides, fongicides conseillés par l’enseignement professionnel à la fin des années 60, époque du tout chimie.
Il voyage, Bordelais, Loire, Champagne et se rend compte que les vins qu’ils aiment ne ressemblent pas à ceux qu’il fait : en Alsace il réalise que la complexité qu’il recherche est liée au volume de terre fouillé par les racines pour survivre et à leur profondeur. Tout commence par le travail du sol.
En 1978 première tentative de vinification comme le faisaient son père et son grand-père, sur 40 ha.
En 1983 nouvelle tentative : vinification et mise en bouteille sans soufre. On le prend pour un fou. Et puis en 1988-89 il atteint au « tout raisin », difficile à maîtriser — attaques bactériennes, recomposition des levures mortes (les lies), odeur désastreuse d’entrailles, amertume… Après vingt ans d’efforts, rien n’est encore gagné. Alors à partir de 1995, il arrête de tâtonner et produit son Morgon en trois cuvées : entièrement nature; non filtrée légèrement sulfitée; filtrée et sulfitée. La réputation de Marcel Lapierre est devenue mondiale, il vend tout son vin chaque année.
Le chapitre « Théorie de la dérive » décrit Lapierre comme  quelqu’un sans dogmatisme, loin des certitudes du discours sur le vin naturel, qui a aimé donner et partager, après avoir été spectateur amusé et complice du situationnisme d’Alain Braik, et de Guy Debord (à droite) qu’il a connu en 1973 après l’auto- dissolution de l’Internationale Situationniste. Il était jeune et n’avait pas encore les responsabilités de vigneron que le décès subit de son père cette année-là va obliger à endosser : Debord avait été pour lui d’abord un compagnon de beuverie à Saint-Germain-des-Prés (5).
quelqu’un sans dogmatisme, loin des certitudes du discours sur le vin naturel, qui a aimé donner et partager, après avoir été spectateur amusé et complice du situationnisme d’Alain Braik, et de Guy Debord (à droite) qu’il a connu en 1973 après l’auto- dissolution de l’Internationale Situationniste. Il était jeune et n’avait pas encore les responsabilités de vigneron que le décès subit de son père cette année-là va obliger à endosser : Debord avait été pour lui d’abord un compagnon de beuverie à Saint-Germain-des-Prés (5).
La révolution « Lapierre l’a accomplie dans la vinification de ses beaujolais en appliquant les principes d’une nouvelle hygiène avec une compréhension à la fois intuitive et scientifique de la microbiologie du vin. »
On pardonnera à Lapaque son anti-américanisme (Robert Parker, le vin californien) sans lequel il ne serait pas tout à fait amateur français, et aussi son Bordeaux bashing à la mode il y a dix ans dogmatique, inutile (« je ne bois jamais de bordeaux, » tant pis pour lui). Son franco-centrisme grande gueule — il ne parle et ne boit que des vins de l’Hexagone, lui qui pourtant proclame qu’aimer la France, c’est aussi, c’est toujours aimer autre chose que la France.
Et aussi sa charge un peu hors sujet contre le bio, même si elle sonne parfois juste : point de salut selon lui hors la certification Demeter, qui garantit que 100% des ingrédients d’un produit sont d’origine bio, les autres, AB et Agriculture biologique ne garantissent finalement pas grand chose.
Et on regrettera qu’il n’évoque pas l’épouse de Marcel Lapierre, Marie, qui a poursuivi l’exploitation en continuant de transmettre à son fils Mathieu et sa sœur Camille le savoir faire de leur père décédé à juste 60 ans : comme le disait Michel Bettane en 2014 au festival Musica Vini, devant Claude Papin (Pierre Bise, Anjou) et Xavier Perromat (Château de Cérons) : pas de grand vigneron sans sa femme…
Adieu Marcel
 Le dernier chapitre, « Le bonheur aux Chênes », la propriété Lapierre étendue, aujourd’hui à sa quatrième génération, est sans doute le plus inspiré (avec l’aide du morgon). Lapaque y a passé plusieurs jours à déguster des bouteilles historiques, des 1985, des 1996, des 2000, « des morgons qui morgonnaient, mais qui souvent pinotaient, grenachaient, carignanaient, embrassant tous les vins que nous aimions, nous faisant voir du paysage, nous racontant des histoires… » Et à échanger avec celui qu’il qualifie d’artiste « plus sensible au rendu qu’à la méthode, […] qui ne s’embarrasse pas de superflu, de phrases, de discours, de colères, […] qui sait ce que faire veut dire et continue de chercher sans forcément trouver. » Touché et touchant, Lapaque regrette de devoir conclure, avec le sentiment de ne pouvoir restituer ces moments de dégustation, de franchise et de friandise qui l’ont marqué à jamais (6).
Le dernier chapitre, « Le bonheur aux Chênes », la propriété Lapierre étendue, aujourd’hui à sa quatrième génération, est sans doute le plus inspiré (avec l’aide du morgon). Lapaque y a passé plusieurs jours à déguster des bouteilles historiques, des 1985, des 1996, des 2000, « des morgons qui morgonnaient, mais qui souvent pinotaient, grenachaient, carignanaient, embrassant tous les vins que nous aimions, nous faisant voir du paysage, nous racontant des histoires… » Et à échanger avec celui qu’il qualifie d’artiste « plus sensible au rendu qu’à la méthode, […] qui ne s’embarrasse pas de superflu, de phrases, de discours, de colères, […] qui sait ce que faire veut dire et continue de chercher sans forcément trouver. » Touché et touchant, Lapaque regrette de devoir conclure, avec le sentiment de ne pouvoir restituer ces moments de dégustation, de franchise et de friandise qui l’ont marqué à jamais (6).
Cette conclusion la voilà, c’est celle de Jules Chauvet, qu’il cite : la perfection d’un vin n’est pas seulement proportion harmonieuse des arômes entre eux et par rapport au tout. Elle est cette mystérieuse circulation qui permet au monde d’en bas de participer à la béatitude de celui d’en haut.
Et maintenant la nôtre, en forme d’ouverture : ce Chez Marcel Lapierre a posé la première pierre du bistro Lapaque de plus en plus fréquenté, ce petit livre fondateur possède les qualités essentielles que l’auteur va développer dans ses ouvrages postérieurs, rares chez un écrivain, car allant au fond des choses, inspectant, écoutant, goûtant, sachant ce qu’il écrit, et croyant à son engagement envers le vin nature. Croire : « ce n’est pas pour croire que je cherche à comprendre, c’est pour comprendre que je crois. Car je crois également que je ne comprendrais pas si je n’avais pas cru, » dixit Saint Antelme de Cantorbéry, cité en exergue de sa Théorie de la bulle carrée qui vient de sortir chez Actes Sud et que nous allons commenter bientôt.
À SUIVRE, DONC…
(1) Sébastien Lapaque a lui-même préfacé un Rabelais et un Madame de Sévigné (Librio); Aux portes des ténèbres : relation de captivité d’Angélique de Saint-Jean Arnaud d’Andilly (La Table Ronde, la petite vermillon); J’ai déjà donné de ADG (Le Dilettante); Sous le soleil de Satan (Le Castor Astral) et Brésil, terre d’amitié (La Table Ronde, la petite vermillon) de Georges Bernanos ainsi que Mon vieil ami Bernanos de Paulus Gordan (Ed. du Cerf); ou encore Panégyrique de Saint François d’Assise de Bossuet (Éd. du Sandre); L’Argot du bistrot, de Robert Giraud (La Table Ronde, la petite vermillon); Des petites fleurs rouges devant les yeux, de Frédéric Fajardie (La Table Ronde, la petite vermillon); et Le Palais de l’ogre, de Roger Nimier (La Table Ronde, la petite vermillon). Serait-il envisageable que ces préfaces soient republiées en un volume ?
(2) Chez Marcel Lapierre a paru chez Stock en 2004 et été réédité en 2010 et 2013 à La Table Ronde, collection la petite vermillon.
(3) « Né et mort au premier siècle de l’ère chrétienne, contemporain de Néron, Pline l’Ancien avait compris beaucoup de choses à travers ses observations de terrain et sa lecture des auteurs anciens. Ainsi avait-il noté la diversité des cépages et la variété des terroirs. Distinguant les vins naturels des vins artificiels, il se désole de savoir qu’il s’est monté des fabriques où l’on maquille le vin à la fumée, le colore et l’aromatise. Il n’a que mépris pour ce vin truqué à la mode de l’Antiquité : « il est un produit de l’art, non de la nature ».
Pline l’Ancien écrit beaucoup mieux qu’on ne le prétend couramment. Ce n’est certes pas Tacite, mais il a de grands moments. « Le vin est aussi une matière à merveille« , jure-t-il en tête du XXIIème chapitre de son étonnant livre XIV d’Histoire naturelle. Mieux que La Pléiade éditée en seule langue vulgaire, l’édition bilingue établie par Jacques André, publié par Les Belles Lettres en 1958 avec une couverture rouge frappée de la louve romaine, que je possède. Je n’abuserai personne en prétendant me régaler exclusivement du latin de Pline imprimé sur les pages de droite. » Sébastien Lapaque in la Revue du Vin de France, 2012 (extraits).
(4) En 2004, outre le Morgon de Marcel Lapierre, Sébastien Lapaque retenait le Fleurie d’Yvon Métras, les aligotés de Michel Couvreur, les Cheverny d’Hervé Villemade et de Thierry Puzelat, Arbois de Pierre Overnoy, Bourgueil de Catherine et Pierre Breton, pinot noirs d’Alsace de Christian Binner, Chinon d’Alain Lenoir, Cornas de Thierry Allemand, Banyuls du Casor des Mailloles, Patrimonio rouge d’Antoine Arena, Mâcon de Gérard Valette, Saumur Château Yvonne, Saint-Joseph d’Hervé Souhaut, Anjou de René Mosse, Plumes d’Ange de Claude Courtois (sauvignon de Sologne), Côtes-du-Rhône Domaine Gramenon, Les Foulards Rouges de Jean-François Nicq (Roussillon)…
(5) Guy Debord disait « je ne connais aucune déception qui résiste à un morgon de Marcel Lapierre, » et écrivait « dans le petit nombre de choses qui m’ont plu, et que j’ai su bien faire, ce qu’assurément j’ai su faire le mieux, c’est boire. Quoique ayant beaucoup lu, j’ai bu davantage. J’ai écrit beaucoup moins que la plupart des gens qui écrivent; mais j’ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent... », un passage de Panégyrique que Marcel Lapierre savait par cœur.
(6) Sébastien Lapaque a publié plus d’une trentaine de romans, nouvelles, récits, essais, pamphlets, anthologies. Et dans le domaine du vin, notamment :
– Théorie de la bulle carrée, Actes Sud, 2019 – Bio et biodynamie, viticulture et sylviculture, histoire et géographie, géologie et botanique. Et littérature…
– Des livres, des vignes, des hommes, des arbres, La Revue des deux mondes (juillet-août 2018), à propos d’Anselme Selosse (Champagne nature, sujet de Théorie de la bulle carrée).
– Avec Yves Camdeborde : Room Service, Actes Sud (2007) et Des tripes et des lettres, Éd. de l’Épure (2007).
– Petit Lapaque des vins de copains, Actes Sud (2006, nouvelle édition en 2009).
– Pot-au-feu au Bristol, chabrot au morgon de Marcel Lapierre, avec Eric Fréchon, Ed. Gérard Guy (2004).
– Deux ou trois fois, cent fois Chinon ! La Revue des deux mondes (janvier 2000), que mtonvin.net va relayer si l’auteur en est d’accord.
– Triomphe de Dionysos – Anthologie de l’ivresse (50 extraits), en collaboration avec Jérôme Leroy, Actes Sud, collection Babel (1999).




 Les choses doivent évoluer. Depuis les trois dernières éditions, la baisse du nombre d’exposants (à peine 1 600 cette année) et de la fréquentation depuis les trois dernières éditions a contraint les organisateurs à un changement profond de modèle. Même si les volumes d’affaires sont restés soutenus nous dit-on, on compte en moyenne 20 à 30% d’exposants et de visiteurs en moins lors des dernières éditions, qui ont lieu une année sur deux.
Les choses doivent évoluer. Depuis les trois dernières éditions, la baisse du nombre d’exposants (à peine 1 600 cette année) et de la fréquentation depuis les trois dernières éditions a contraint les organisateurs à un changement profond de modèle. Même si les volumes d’affaires sont restés soutenus nous dit-on, on compte en moyenne 20 à 30% d’exposants et de visiteurs en moins lors des dernières éditions, qui ont lieu une année sur deux.
 Ouverture sur les États Unis
Ouverture sur les États Unis







 Un grand personnage de Bordeaux vient de quitter notre monde : André Lurton, propriétaire des châteaux bordelais Couhins-Lurton, La Louvière, Bonnet, Cruzeau, Rochemorin, Barbe-Blanche, Coucheroy, Guibon, Quantin, nous a quittés à l’âge de 94 ans.
Un grand personnage de Bordeaux vient de quitter notre monde : André Lurton, propriétaire des châteaux bordelais Couhins-Lurton, La Louvière, Bonnet, Cruzeau, Rochemorin, Barbe-Blanche, Coucheroy, Guibon, Quantin, nous a quittés à l’âge de 94 ans.

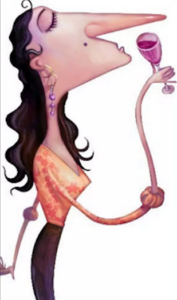 It never really seems to go away, does it? France continues to debate whether or not wine is simply a form of alcohol or a cultural beverage.
It never really seems to go away, does it? France continues to debate whether or not wine is simply a form of alcohol or a cultural beverage.  But let’s not. Let’s agree with Didier Guillaume for a moment and say that all wine is indeed a cultural product and, by association, the most exalted of drinks. Wine drinkers therefore are, if not actually snobs, then wannabe snobs. Wine is the vehicle for and to our snobbery. It might even be unconscious. My father once told me how his uncle tried to point out that there was no such thing as a socialist. « Sure, they all belong to the Labour party, » he said.
But let’s not. Let’s agree with Didier Guillaume for a moment and say that all wine is indeed a cultural product and, by association, the most exalted of drinks. Wine drinkers therefore are, if not actually snobs, then wannabe snobs. Wine is the vehicle for and to our snobbery. It might even be unconscious. My father once told me how his uncle tried to point out that there was no such thing as a socialist. « Sure, they all belong to the Labour party, » he said. Ce pourrait être LA révolution de la viticulture. Planter des cépages résistants en évitant tout traitement phytosanitaire dans le vignoble.
Ce pourrait être LA révolution de la viticulture. Planter des cépages résistants en évitant tout traitement phytosanitaire dans le vignoble. 



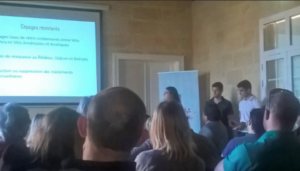
 C’est Sébastien Lapaque (ci-contre). Romancier, essayiste et pamphlétaire, latiniste, journaliste au Figaro Magazine, au Monde Diplomatique, au Point, pigiste un peu partout, « talentueux écrivain de droite qui dit merde à la droite » selon l’Obs, il nous a confectionné un petit article savoureux — forcément savoureux venant de lui qui a pour ami le cuisinier béarnais Yves Camdeborde (1) –, dans La Revue des Deux Mondes de mai 2019 (pp. 100- 106) : une visite des préfaciers du Livre de Poche des débuts.
C’est Sébastien Lapaque (ci-contre). Romancier, essayiste et pamphlétaire, latiniste, journaliste au Figaro Magazine, au Monde Diplomatique, au Point, pigiste un peu partout, « talentueux écrivain de droite qui dit merde à la droite » selon l’Obs, il nous a confectionné un petit article savoureux — forcément savoureux venant de lui qui a pour ami le cuisinier béarnais Yves Camdeborde (1) –, dans La Revue des Deux Mondes de mai 2019 (pp. 100- 106) : une visite des préfaciers du Livre de Poche des débuts. Parce qu’évidemment, il connaît le vin et qu’il a écrit un Chez Marcel Lapierre — vigneron pionnier du bio à Villié-Morgon que tout le monde respectait avant sa mort en 2010 et ne cesse de vénérer depuis. Ce petit livre paru en 2004 campe bien l’ambition de notre blog : goût, connaissance et culture du vin, placé sous le signe de la littérature et de la poésie, soignant la langue et le phrasé du récit, avec curiosité, sincérité des dégustations, bienveillance et fidélité envers les vigneronnes et vignerons.
Parce qu’évidemment, il connaît le vin et qu’il a écrit un Chez Marcel Lapierre — vigneron pionnier du bio à Villié-Morgon que tout le monde respectait avant sa mort en 2010 et ne cesse de vénérer depuis. Ce petit livre paru en 2004 campe bien l’ambition de notre blog : goût, connaissance et culture du vin, placé sous le signe de la littérature et de la poésie, soignant la langue et le phrasé du récit, avec curiosité, sincérité des dégustations, bienveillance et fidélité envers les vigneronnes et vignerons.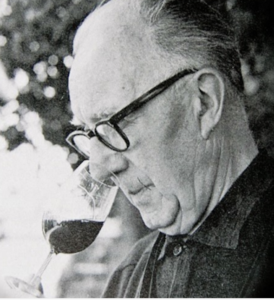 qui se propageait en direct sur les écrans de télévision de l’hôtel, j’étais passé à côté de ce petit chef d’œuvre de précision historique et d’amour fou, qu’un simple survol ne peut satisfaire. Sébastien Lapaque nous parle notamment de Jules Chauvet (à droite), qu’il qualifie de « Bouche d’or » (déguster et dire le vrai), négociant-éleveur en Beaujolais, chercheur et pédagogue, mort en 1989 à 82 ans. Cet homme d’hier et d’après-demain a le premier réénoncé les règles de la viticulture bio bien avant qu’on la nomme ainsi, en professant de « libérer les vins des levures exogènes, de la chaptalisation, de la filtration, de l’acide tartrique et surtout de ce maudit anhydride sulfureux qui fait tant de mal. » Si Lapaque en parle longuement c’est qu’il a beaucoup influencé Marcel Lapierre, parmi tant d’autres.
qui se propageait en direct sur les écrans de télévision de l’hôtel, j’étais passé à côté de ce petit chef d’œuvre de précision historique et d’amour fou, qu’un simple survol ne peut satisfaire. Sébastien Lapaque nous parle notamment de Jules Chauvet (à droite), qu’il qualifie de « Bouche d’or » (déguster et dire le vrai), négociant-éleveur en Beaujolais, chercheur et pédagogue, mort en 1989 à 82 ans. Cet homme d’hier et d’après-demain a le premier réénoncé les règles de la viticulture bio bien avant qu’on la nomme ainsi, en professant de « libérer les vins des levures exogènes, de la chaptalisation, de la filtration, de l’acide tartrique et surtout de ce maudit anhydride sulfureux qui fait tant de mal. » Si Lapaque en parle longuement c’est qu’il a beaucoup influencé Marcel Lapierre, parmi tant d’autres. Marcel Lapierre né en 1950 (ci-contre), avant même de rencontrer « le Socrate du Beaujolais » Jules Chauvet, « se faisait une certaine idée du vin, » s’employant à « rentrer en cave un gamay noir à jus blanc, riche de ses seules levures indigènes. »
Marcel Lapierre né en 1950 (ci-contre), avant même de rencontrer « le Socrate du Beaujolais » Jules Chauvet, « se faisait une certaine idée du vin, » s’employant à « rentrer en cave un gamay noir à jus blanc, riche de ses seules levures indigènes. » quelqu’un sans dogmatisme, loin des certitudes du discours sur le vin naturel, qui a aimé donner et partager, après avoir été spectateur amusé et complice du situationnisme d’Alain Braik, et de Guy Debord (à droite) qu’il a connu en 1973 après l’auto- dissolution de l’Internationale Situationniste. Il était jeune et n’avait pas encore les responsabilités de vigneron que le décès subit de son père cette année-là va obliger à endosser : Debord avait été pour lui d’abord un compagnon de beuverie à Saint-Germain-des-Prés (5).
quelqu’un sans dogmatisme, loin des certitudes du discours sur le vin naturel, qui a aimé donner et partager, après avoir été spectateur amusé et complice du situationnisme d’Alain Braik, et de Guy Debord (à droite) qu’il a connu en 1973 après l’auto- dissolution de l’Internationale Situationniste. Il était jeune et n’avait pas encore les responsabilités de vigneron que le décès subit de son père cette année-là va obliger à endosser : Debord avait été pour lui d’abord un compagnon de beuverie à Saint-Germain-des-Prés (5). Le dernier chapitre, « Le bonheur aux Chênes », la
Le dernier chapitre, « Le bonheur aux Chênes », la 